Dans son dernier roman, le Colombien Juan Gabriel Vásquez retrace la vie du cinéaste Sergio Cabrera, sa formation politique, militaire mais aussi artistique, en l’inscrivant plus largement dans la trajectoire de sa famille : ses grands-parents, républicains espagnols exilés en République dominicaine puis au Venezuela, et en Colombie ; et son père, militant maoïste qui entraïna sa famille dans la Chine de la Révolution culturelle.
Juan Gabriel Vásquez, Une rétrospective. Trad. de l’espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon. Seuil, 464 p., 23 €
Écrit par Florence Olivier
« Être colombien est un acte de foi. » Qui n’a entendu cette réplique d’un personnage de Borges dans la bouche de tel ou tel intellectuel colombien ? Détournée de son sens premier – la mise à nu de tout sentiment national –, elle résume, non sans une salutaire dérision, la déception voire le désarroi du discoureur face à la persistance de la violence politico-militaire ou de celle du narcotrafic dans l’histoire colombienne. Si Juan Gabriel Vásquez ne reprend pas ce lieu commun, il tient à rappeler que, né en 1973, il n’a jamais connu de période de paix dans son pays. Ferme partisan de l’application des accords de paix de 2016, âprement négociés entre le gouvernement et la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), l’écrivain entend apporter dans Une rétrospective des éclairages aussi crus que nuancés sur divers pans de ce passé toujours brûlant. Hanté par les métamorphoses de la violence politique qu’a connue la Colombie depuis le XIXe siècle, Juan Gabriel Vásquez renchérit dans ce dernier roman sur plusieurs de ses paris coutumiers : narrer l’incidence de l’histoire sur les vies privées des citoyens ; manier la relation entre père et fils comme métaphore du conflit historique ; mener son récit à la manière d’une enquête mémorielle ; façonner une fine marqueterie entre fiction et faits réels recueillis auprès de témoins. Le tout avec un talent de conteur qui tient son lecteur en haleine.
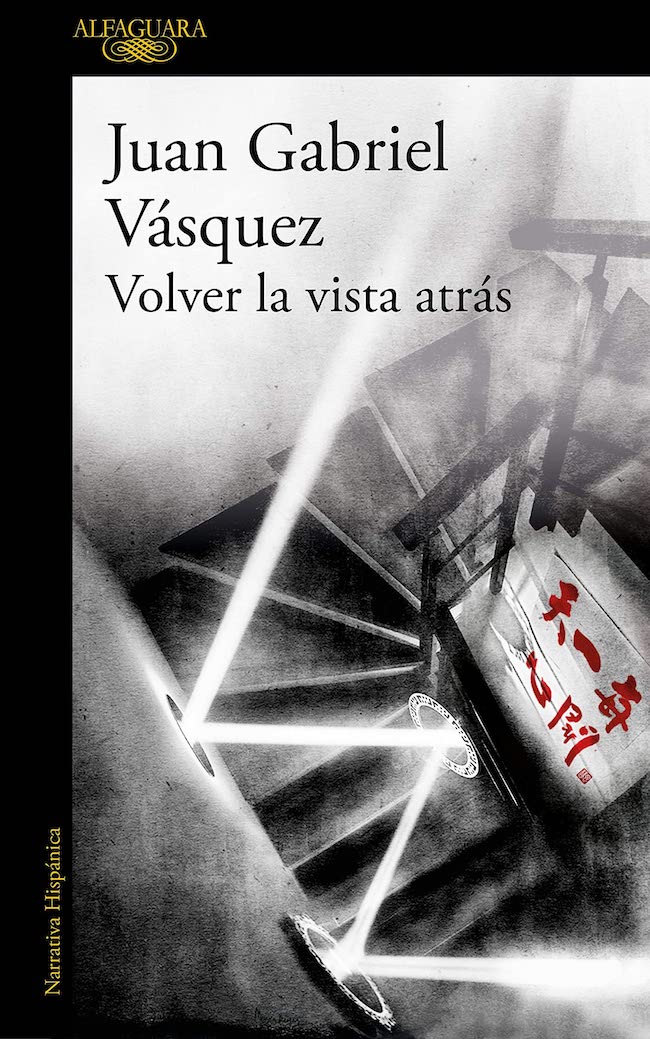 Éditions Alfaguara
Éditions AlfaguaraUne rétrospective, titre qui transpose éloquemment celui de la version originale – Volver la vista atrás est un vers d’Antonio Machado –, se veut une fiction fondée uniquement sur des faits réels, survenus dans la vie du cinéaste colombien Sergio Cabrera. À l’exacte façon du Limonov d’Emmanuel Carrère ? On suivra plutôt Juan Gabriel Vásquez, qui, dans une « Note de l’auteur », précise l’acception qu’il retient ici du verbe « feindre » : « Modeler, concevoir, donner forme à quelque chose ; a) pour désigner des objets physiques tels que des sculptures et objets similaires, tailler. »
C’est, en effet, dans la surabondance des péripéties d’une vie exceptionnelle qu’il lui aura fallu tailler son récit. Inséparable de l’histoire de sa famille, l’expérience de Sergio Cabrera est non moins inséparable de l’histoire colombienne et de celle, internationale, de la gauche révolutionnaire. Une geste tumultueuse et tout à la fois une vie picaresque dont les souvenirs, longtemps tus, occultés ou perçus de biais par celui-là même qui aura vécu ces événements, s’assemblent enfin pour trouver un sens. L’intime réconciliation du cinéaste avec son passé, et donc avec sa capacité de créer et d’aimer au présent, met en anamorphose celle qui pourrait advenir dans l’histoire colombienne et que l’auteur, tout comme le personnage de Sergio Cabrera, appelle ardemment de ses vœux.
Passé et présent du cinéaste se percutent violemment en 2016 tandis qu’à la Cinémathèque de Barcelone se déroule une rétrospective de l’œuvre de Sergio Cabrera. L’application des accords de paix vient d’être rejetée, lors d’un référendum, par une courte majorité de citoyens colombiens. Le cinéaste traverse une grave crise existentielle : en manque d’inspiration, en butte aux reproches de ses producteurs, il vit en Colombie tandis que sa dernière femme, portugaise, s’est réinstallée au Portugal, y emmenant leur fille de cinq ans. Lorsqu’à Lisbonne, sur le chemin de Barcelone, Sergio apprend la mort de son père, il décide, sans plus d’explications, de ne pas rentrer à Bogota pour assister aux obsèques de Fausto Cabrera. Dès cet instant, la rétrospective de son œuvre cinématographique se double d’une rétrospective intime qui, à travers les souvenirs du père, ramène Sergio à ceux de sa propre vie. Tel est le principe temporel que suit le récit d’Une rétrospective. Crise du personnage et crise nationale coïncident dans le temps, et il n’échappera à nul lecteur que le roman de Juan Gabriel Vásquez sonde le passé du premier pour rouvrir puis panser les plaies d’un pays qui les a laissées à vif.
 Affiche de « La stratégie de l’escargot » de Sergio Cabrera (1993)
Affiche de « La stratégie de l’escargot » de Sergio Cabrera (1993)Si le suspense de l’enquête mémorielle que le romancier manie en virtuose dans Le bruit des choses qui tombent (2012) est moindre dans cette chronique biographique, l’habile effet d’aller-retour entre présent et passé y supplée. Les lieux que traverse ou qu’aura habités Sergio Cabrera – mais aussi son père, Fausto, son grand-oncle, Felipe, son grand-père, Domingo, sa mère, Luz Elena, sa sœur, Marianella – ne jouent pas un rôle mineur dans l’afflux et l’ajustement de ses souvenirs sous un nouveau jour. Comme souvent chez Juan Gabriel Vásquez, une cartographie mémorielle surgit de la forme d’une ville ou d’une région, voire de celle d’un pays tout entier, car tout lieu, hanté, est lieu de mémoire.
Les trois longues parties de ce roman biographique embrassent l’histoire de trois générations de Cabrera, depuis les années qui ont précédé la guerre civile espagnole jusqu’en cette année 2016 où Barcelone accueille et célèbre le cinéma de Sergio Cabrera. C’est cette même ville qu’avaient dû fuir, peu avant qu’elle ne tombât aux mains des troupes franquistes, les républicains Felipe, officier et combattant héroïque de l’armée de l’air catalane, son beau-frère et garde du corps Domingo, les deux fils de ce dernier, Fausto et son frère Mauro. De cette histoire de lutte, de défaite et d’exil, nul membre de la famille, descendants y compris, ne pourra se dépêtrer avant bien longtemps. Les Cabrera exilés vivront une vie picaresque dans la République dominicaine du dictateur Trujillo, puis au Venezuela, enfin en Colombie, où ils se fixeront.
La vocation d’acteur du jeune Fausto – née de l’indéfectible alliance entre les idéaux de la République espagnole, côté communiste, et l’amour de la poésie que cultive sa famille – fera de lui une indispensable figure d’avant-garde dans les milieux du théâtre puis du théâtre télévisé en Colombie. C’est cet homme, fantasque et dogmatique, enjôleur et autoritaire, qui, convaincu d’œuvrer pour le bien de tous, façonnera les destins de ses enfants, Sergio et Marianella, qu’il ralliera à la cause de la révolution internationale à l’heure du maoïsme. Lui-même n’était-il pas fasciné, donc façonné, par l’image héroïque de son oncle Felipe ? Voici donc, illustrée à la perfection, l’une des approches de l’histoire que privilégie le romancier Juan Gabriel Vásquez : l’entrelacs indémêlable entre histoire individuelle et histoire collective. L’expérience de vie de Sergio Cabrera aura été modelée par celles de son père, de son grand-oncle, de son grand-père ; elle trouve son origine et sa couleur dans l’idéologie de la gauche internationale des années 1930 et dans la culture républicaine espagnole où art et politique se fondaient l’un dans l’autre. Et quelle expérience !
C’est dans la Chine de la Révolution culturelle, où Fausto a été recruté en tant qu’expert par l’Institut des langues étrangères de Pékin, que Sergio et sa sœur se formeront dans leur adolescence. De l’implacable solidité de cette formation font foi nombre de documents éloquents dans la deuxième partie et jusque dans l’épilogue du roman : des photographies, des extraits du journal de Marianella écrit en chinois ou des passages d’une fort longue lettre du père qui tient lieu de bréviaire ou de manuel de survie pour ses enfants restés seuls en Chine. Au lecteur de juger sur pièces. Portés par l’enthousiasme paternel pour le régime de la Chine populaire, endoctrinés, Sergio et Marianella ne cessent de solliciter de nouvelles tâches militantes : travail dans une commune à la campagne puis en usine, engagement dans des groupes de Gardes rouges, enfin, ultime privilège, entraînement militaire. C’est qu’ils doivent parfaire leur formation avant de rejoindre leurs parents, repartis sans eux en Colombie, pour s’engager à leur tour dans la lutte de la guérilla maoïste.

Le récit de cette dernière période de leur jeunesse fait la matière de la troisième partie du roman. Et il serait bien court de dire que c’est celui d’un désenchantement. L’absurdité, l’égarement au sens propre comme au sens figuré, la folie, la violence meurtrière, y sont associés à la guérilla tout comme à la forêt tropicale où évoluent les troupes. On y lit un juste hommage à la tradition latino-américaine du roman de la selva, dont La Voragine (1924) du Colombien José Eustasio Rivera est l’une des illustrations magnifiques. Aliénés, les jeunes gens et leurs parents parviendront, au terme de rudes péripéties, à quitter la guérilla colombienne sans abjurer la cause maoïste. Sergio, Fausto et Luz Elena repartiront en Chine populaire.
Une rétrospective peut être lu comme un roman de (dé-)formation conté à rebours mais aussi comme un roman d’artiste. Car, au récit de l’initiation politique et militaire de Sergio Cabrera, se mêle celui de son précoce apprentissage artistique d’acteur puis de photographe aux côtés de son talentueux père. Plus tard, le jeune militant maoïste vole des instants à ses devoirs de révolutionnaire pour voir des films dès qu’il en trouve l’occasion. Tout comme Fausto avait su braver les obstacles de sa condition d’exilé pour devenir acteur, Sergio saura trouver dans sa vocation de cinéaste la force d’échapper à l’emprise de ce père tant aimé et tant admiré. Loyal, il fera jouer Fausto dans la plupart de ses films. Les chapitres consacrés à la rétrospective barcelonaise de 2016 revisitent avec acuité l’œuvre du cinéaste, politique et parodique tout à la fois. Où l’on voit qu’Une rétrospective propose une vision de l’engagement artistique qui, précisément, permettrait de libérer l’art de l’emprise de l’idéologie ou, mieux encore, d’user du premier comme d’un antidote contre la seconde.
L’épilogue du roman fait coïncider avec la rétrospective cinématographique de Barcelone l’ultime émancipation de Sergio Cabrera, tourné non plus vers le passé mais vers l’avenir, non plus vers son seul père défunt mais aussi vers son fils de dix-huit ans. À ce dernier, il aura transmis son histoire, enfin revue jusque dans ses recoins les plus sombres, ainsi que celle, inoubliable, de Fausto et de la famille Cabrera. L’art d’hériter sans soumission et l’art de transmettre, tels sont les épineux défis que relèvent et le personnage de Sergio Cabrera et le romancier Juan Gabriel Vásquez. Car on ne verra nul hasard dans le prix biennal de roman Vargas Llosa qu’a reçu, en 2021, Une rétrospective. Parmi les maîtres latino-américains de l’écrivain se côtoient en effet, réconciliés par leur libre héritier malgré leurs différends idéologiques, le Péruvien Mario Vargas Llosa et le Colombien Gabriel García Márquez. Négociateur hors pair, Juan Gabriel Vásquez sait confronter sans ciller les versions en conflit du passé politique et littéraire colombien, latino-américain, mondial. Être romancier est un acte de foi.
[Source : www.en-attendant-nadeau.fr]
Sem comentários:
Enviar um comentário