
«Un jour, je m’éveillai tout hébété à mon destin véritable.»
O. V. de Milosz, L’amoureuse initiation
Écrit par Juan Asensio
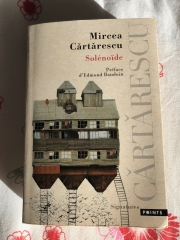
Ces intensités nocturnes – à l’instar d’un Prométhée qui se déchaînerait toujours en amont ou en aval de son répétitif châtiment – prirent la forme de nombreuses décennies de claustration qui permirent d’accumuler au sein d’un logement de fortune des milliers de pages et des quantités non moins énormes d’aquarelles. L’homme qui allait d’un emploi ingrat à un autre emploi ingrat possédait en réalité un refuge, un passage souterrain sous les décombres de son invisible personnalité publique : il avait la capacité de faire abstraction de sa banalité sociale et de vivre en lui-même et pour lui-même à l’égal d’un singulier démiurge refaisant le monde selon des critères davantage équitables – ne serait-ce déjà que pour juger les maudits bourreaux d’enfants et leur ôter artistiquement toute faculté de nuisance, tel un Dickens s’étant consacré à une littérature allégoriquement justicière pour sauver l’enfant qu’il avait incarné et pour condamner les adultes qui font la guerre à l’innocence, tel encore un résistant Armel Guerne à la remorque de la Seconde Guerre mondiale enfin terminée, noircissant des lignes spastiques mais belles in the hit of the moment, héros déconcerté par ces «enfants retournés à la mort les yeux remplis de gris», homme de loyauté affligé par le troupeau des collaborateurs, découragé sans doute par la diffamation qui a trop longtemps outragé les purs et durs, les compagnons de la France Libre, défait d’avoir «mal au mal qu’on nous a fait» (1) en usant d’une méthodique inhumanité, certainement sidéré de constater l’intransigeante évidence qui certifie la victoire du vice et la déchéance de la vertu – tout compte fait : le glas d’une ère qui eût pu sauver ses enfants de justesse et le début d’un temps maléfique où plus aucune candeur n’a l’air tolérée. Que ce soit Guerne ou Darger, Dickens aussi forcément, ces trois-là ne purent se résoudre à être du côté de «tous les malins de ce monde qui savent, savent si bien ne plus y penser», savent se laver les mains du «dessèchement de l’amour» (2) et du satanisme qui compromet gravement le séraphisme. Pour eux trois, il est indubitable que l’enfant est un sauveur, un abri, un talisman, et l’on verra que Mircea Cărtărescu ne siège pas en dehors de cette respectable assemblée dont le sociétaire américain l’a particulièrement ému. L’union de ces hommes, dût-on la trouver arbitraire parce qu’elle provient de notre foi, n’en constitue pas moins le chœur qui pourrait chanter «le cantique de l’amour», «l’amour candide de demain», le halo susceptible d’exorciser «les très-obscènes et sentencieuses larves de la banalité» (3) assassine qui d’une part, directement, envoyèrent par leur servitude un nombre incalculable de justes à l’échafaud, et qui, d’autre part et indirectement, eussent pu croire que Darger était des leurs à cause de sa prosaïque façade.
Tout roman (disions-nous au préalable de cette nécessaire digression) qui se soucie d’Henry Darger – lors même que ce souci se vérifierait seulement par le biais de deux discrètes occurrences – ne peut assurément que participer à la mémoire de ce titan d’Amérique en essayant d’être fidèle à ses convictions, à sa démesure et à son absence totale de considération pour ses lecteurs éventuels. Ce n’est que sous le regard d’un dieu de justice ou d’une entité apparentée que Darger a composé son œuvre surdimensionnée. Il ne songeait nullement à publier, de la même façon qu’il ne s’estimait nullement romancier ou artiste, comme c’est le cas du narrateur de Solénoïde de Mircea Cărtărescu (4), faisant deux allusions a priori intempestives au surnaturel vengeur de Chicago mais empruntant à plus d’un titre son inimitable sillon de fécondité (avant de se reconvertir dans une fécondité encore plus éloquente et plus à-propos pour lui-même). Comparativement à Darger, le narrateur de Solénoïde, parfois miscible aux obsessions et aux éléments biographiques de Cărtărescu (déjà par son année de naissance), parcourt le chemin de l’aventure humaine en paria fantomatique. Et séparément de ce que furent les circuits ascétiques du visionnaire de l’Illinois, ce n’est pas dans la gigantale agglomération de Chicago qu’il évolue, opprimée par les parois exponentielles de ses immeubles et par le pullulement d’une mentalité analogue à la psychologie d’un George F. Babbitt (5), mais dans la mégalopole de Bucarest, asphyxiée par la ruine et par toutes les gradations de l’effondrement, comme une espèce de cité américaine qui se serait écroulée sous le poids de son échec, animée à l’origine ou lors d’un chapitre de son expansion par une âme typique du Nouveau Monde conquérant, puis rattrapée par la sénilité de l’Ancien Monde européen dont les idéaux ont pu être massacrés par les idéologies.
Mais l’un dans l’autre, le Chicago de Darger et le Bucarest de Cărtărescu peuvent se confondre, la première moitié du XXe siècle de Chicago, inapte à reconnaître ses génies en les abandonnant au sort de la marginalisation et du libéralisme, pouvant préfigurer la seconde moitié du XXe siècle à Bucarest, prise dans l’étau du communisme et dans le régime dévitalisant de Nicolae Ceausescu, oiseau de malheur de la Roumanie, obscure silhouette que le narrateur de Solénoïde ne cite à aucun moment mais dont nous percevons continûment la gluante et dérangeante présence. En outre, exactement comme Darger, similairement aux jours insignifiants et aux nuits extraordinaires de ce dernier, le personnage de Cărtărescu travaille dans le mystère et l’ermitage de son domicile tout en exerçant la profession ordinaire de professeur de roumain dans une école excentrée de tout prestige. Rien (ou presque) n’est à cet égard central dans Solénoïde puisque tout a lieu en périphérie, en bordure, sur le rebord de Bucarest et en exfiltration des moindres sources d’intérêt que l’on accorde généralement au fait de vivre (et surtout au fait de bien vivre). De là émerge la thématique du secret, la nette impression que Darger fut un impénétrable secret pour son époque, un indéfinissable et inassimilable individu, le sentiment aussi que Bucarest et toutes ses milices de surveillance ne parviendront jamais à percer le coffre occulte de cet enseignant de roumain, l’un et l’autre étant des étoiles insaisissables parmi la constellation des mornes soleils de leurs quotidiens respectifs, l’un et l’autre s’acharnant à comprendre quelque chose de leur vie et de l’universalité de la condition humaine, l’un et l’autre, en somme, étant des «[bannis] de l’univers» dotés des compétences pour diagnostiquer la force cosmique de l’ostracisme, l’un et l’autre possédant un mode d’existence où le secret a pu devenir une «forme suprême d’intervention en ce monde» (6). Ainsi faisons-nous d’Henry Darger et de l’étrange raconteur de Solénoïde des sortes d’agents secrets du secret, des sortes d’opérateurs ontologiques du secret, un binôme qui n’eût pas d’autre élan que celui du secret, de la secrète discrétion, mais qui sut agir significativement au milieu du torrent existentiel, qui sut deviner dans la circonférence des choses un avant-poste du nombril de l’Être, une esquisse du noyau intersidéral où viennent se greffer les vérités ultimes et indicibles, un binôme semblable si l’on veut à une franc-maçonnerie solitaire qui n’avait pour frère et pour loge que le secret et rien que le secret – encore qu’il faudrait nuancer un peu pour le pédagogue de Solénoïde car sa démentielle solitude sera quelquefois atténuée par des rencontres décisives.
Il est troublant du reste que l’énigmatique narrateur de Cărtărescu revienne à plusieurs reprises sur le sabotage de sa carrière d’écrivain par un sévère et insensible collège de critiques alors qu’il écrit le journal le plus désarçonnant et révolutionnaire que l’on puisse lire (comme si Julien Green avait été subitement trépané et que l’on aurait enfoui à l’intérieur de sa boîte crânienne une partie du cerveau de Philip K. Dick). Il s’imagine que la disqualification de son poème intitulé La Chute a définitivement anéanti ses chances de renouveler le champ littéraire de la Roumanie et probablement du monde entier. Il lui arrive même de fantasmer une galaxie parallèle où il serait cet écrivain à succès, cet écrivain légitimé, cet écrivain qui aurait été validé dans un genre d’atelier d’écriture, dans un genre d’amicale des poètes bucarestois aussi louche que les conventicules de métromanes qui ont essaimé au sein du Mexico D.F. de Roberto Bolaño et que le romancier chilien a aimé brocarder ou révérer. Il n’en demeure pas moins que cette précoce élimination du narrateur par le soi-disant terrain officiel de la littérature l’a immédiatement inscrit parmi les dignes descendants d’Henry Darger. Puisque son talent n’a pas été reconnu, puisque les prétendues autorités esthétiques de Bucarest n’ont pas su lire sa poésie comme les bons citoyens de Chicago n’ont pas su déchiffrer le prodige cognitif de Darger, il devait éprouver d’emblée une expulsion de la norme et cultiver l’interminable nomenclature de ses anomalies (avec ses rêves bizarres en guise de sommet morbide, des rêves où alternent des ambiances picturales proches des tableaux de Füssli et des rêves entomologiques allant jusqu’à l’accouplement avec une vermine confusément anthropomorphe). C’est pourquoi la lecture de Solénoïde pourra paraître pénible à certains, ne fût-ce déjà que par le volume de l’ouvrage et par sa constante perquisition de l’aberration multimodale qui est à l’avenant de cette acromégalie romanesque. La lecture semblera aussi ardue en raison du large faisceau d’hypothèses qui sont testées (des hypothèses à la fois formelles et philosophiques), ardue encore par la répétition du délire onirique et par les soudaines incursions dans le domaine du fantastique, par le sentiment de fréquenter d’inédits et terrifiants corridors du château de Bran, sans parler d’une terminologie volontairement organique et souvent nosographique tant le narrateur insiste sur son état maladif, sur les parties souffrantes de son corps et de son esprit, sur la maladie de Bucarest et possiblement la maladie planétaire, sur le Mal insatiable qui ronge le monde et dont il se fait le porte-parole tutélaire, sur ce Mal holistique et peut-être incurable mais qui doit néanmoins nous encourager à ressaisir la réalité selon des angles sains, selon une mathématique d’initiés qui pourrait nous sauver de ces visions terribles et nous indiquer une algèbre divine derrière la dyscalculie des civilisations.
Au fond, Mircea Cărtărescu s’amuse à repousser le périmètre de l’expérimentation littéraire tout en proposant un roman worthy of the name, en l’occurrence, ici, le roman d’un Don Quichotte de la secrète configuration du réel, le roman d’un détective de la Forme platonicienne déboussolé par l’invulnérable et inexplicable devenir, le roman d’un fou furieux sporadiquement intuitif qui traque la suprême Intuition par-delà ses crises de rationalité, par-delà ses instincts tortueux et par-delà ses fastidieuses semaines d’enseignement. En cela, Cărtărescu revisite beaucoup de fantaisies qu’il a pu développer naguère dans son surprenant Orbitor, dans cette transcendante science-fiction, mais, cette fois, il va plus loin dans l’audace, plus loin dans la démiurgie, comme s’il se galvanisait par le truchement de son personnage, comme s’il était ce double de la galaxie parallèle tout à l’heure évoqué, cet écrivain réputé, nobélisable et installé, soufflant à son homologue fictif le substantiel pneuma de la littérature qui lui ferait défaut dans la mesure où les contrôleurs des travaux littéraires n’ont pas apprécié sa vaillante Chute – à moins tout au contraire qu’il ne faille lire Solénoïde comme un témoignage de ce que serait la littérature hors de n’importe quelle académie : une liberté inestimable que même Mircea Cărtărescu pourrait regretter, compte tenu désormais de sa reconnaissance internationale et par conséquent de son statut d’antinomie vis-à-vis de tous les Henry Darger recensés et spécialement non recensés.
Retenons toutefois que l’immensité de la tentative du narrateur – déceler l’indécelable ou sonder l’insondable – se déroule dans le secret absolu de ses recherches et les méandres de son off-center diary. Il faut ainsi l’appréhender comme un grand écrivain en puissance eu égard à la complète actualisation de ses ratages, à ses passions mystagogiques et à sa mélancolie professorale (pour ne pas dire sa mélancolie congénitale), car la grandeur en écriture ne peut aller de pair qu’avec une forme de lassitude sociale, un système de pessimisme assorti d’un système d’extase, voire une circonstance d’invisibilité de soi-même où l’on tend à repousser ce qui nous éclipse pour apostropher quelque improbable lueur, quelque improbable feu sacré qui brillerait derrière les faux temples des gloires éphémères. Là où se décident les notoriétés matérielles aux seules conséquences pratiques, cet homme du périphérique de Bucarest ne peut pas être, mais là où potentiellement se décide l’indécidable pour un cerveau médiocre, là où se fomente une envisageable intrigue métaphysique réservée aux consciences éclairées, il pourrait vraiment être – en d’autres termes : ses virtualités sont désagréablement retenues et il se met à compenser cette rétention dans l’espace-temps exotérique en décuplant sa monomanie pour un espace-temps ésotérique où les serrures les plus coriaces seraient selon lui sur le point de céder.
Et par rapport à cette mélancolie qui entraîne un pessimisme de la force et consécutivement une envie de s’édifier, de reprendre place dans un ordre plus juste, par rapport à ce désarroi qui s’empare un jour de tout enseignant dévoré par le fulgurant non-sens de sa mission (peut-être l’absurdité corrélée des collègues inanimés et des élèves indifférents), il faut se faire une idée par exemple des médisances qui l’ont possiblement accablé, lui, le prospecteur de l’irreprésentable, le scrutateur d’une voie lactée philosophale, qui l’ont dénigré dans son école et qui l’ont peu à peu déporté sur le terrain d’une surhumaine libido sciendi traduite en manuscrits surabondants : s’il avait du talent, s’il savait faire autre chose que ressasser les mêmes rengaines pédagogiques, s’il avait de quoi être quelqu’un, un vrai de vrai, s’il était the real deal (ont dû colporter les malveillants), il ne serait pas dans cet établissement scolaire et il serait l’écrivain que toute une nation attend. Mais c’est précisément parce que cet éducateur désabusé est tout cela, qu’il est sublime et doué, monumental et pionnier, qu’il végète dans ce bahut kafkaïen aux innumérables bâtiments et à l’architecture indéfinie, et que, une fois libéré de ses journées assommantes, il s’engage dans le biotope encore plus kafkaïen de sa maison, une espèce de monastère de l’Escurial exprimé par Dalí et se contorsionnant pour auto-engendrer de nouvelles pièces et de nouveaux passages secrets, amplifiant les obsessions de son occupant, exacerbant ses volontés de cartographier une intarissable réalité, le confortant de surcroît dans son opinion que le monde autour de son hétéroclite foyer dissimule des tréfonds autrement plus étonnants et essentiels pour la suite de l’histoire humaine. En dehors donc des réseaux mondains et des réseaux de compréhension habituels, le narrateur s’enfonce de plus en plus dans les infinis présumés qui nous régissent, l’infiniment grand et l’infiniment petit, abîmes où respirent de considérables secrets, et il s’y enfonce en secret, en scaphandrier des océans inexplorés. Par là même il nous incite à estimer son périple à sa juste valeur : ce sont les actes et les crédos les plus anonymes, les plus compulsifs, qui ont les meilleures chances de refaçonner le paradigme dominant et d’apporter aux contemporains de cette épistémologie officieuse des perspectives radicalement novatrices. En d’autres mots, le narrateur de Solénoïde pourrait bien être celui par lequel une révélation advient, celui par lequel une perception jusqu’ici inconnue se manifeste, celui qui pourrait divulguer une suite de Fibonacci au verso de tous nos désordres, au dos du foisonnement de la nature, au principe de nos propres créations, tel Krasznahorkai méditant sur l’hermétique beauté guidant le monde dans Seiobo est descendue sur terre. Mais tandis que László Krasznahorkai a imité une sorte de perfection cachée parmi les pages éblouissantes de Seiobo, l’ouvrage de Mircea Cărtărescu, à l’inverse, s’engloutit ou plutôt s’engouffre vers des strates de réalité de moins en moins parfaites, de moins en moins recommandables, entretissées cependant d’une mystique mathématicienne, suggérant que la perfection et l’imperfection ne sont que des cas particuliers d’un schéma suprasensible – ou d’une énergie, d’une omniprésence solénoïdale – éminemment différent de ce à quoi des siècles de réflexion nous ont accoutumés.
Ce faisant les abstractions les plus éthérées côtoient les composants les plus trivialement concrets au cœur de ce livre inclassable. Au registre des abstractions, on se souviendra des séquences hallucinées concernant la quatrième dimension et les travaux de Charles Howard Hinton à ce sujet. Les avancées cruciales du savant Hinton sont restituées non pas comme un point isolé sur la tapisserie de l’univers, mais, tout à rebours de cela, comme un authentique motif transitionnel dans le tapis de l’incommensurable réel, comme un nœud gordien indénouable à partir duquel pourrait néanmoins se démasquer telle ou telle innervation de la substance des choses. D’où ces extrapolations et autres digressions mirobolantes sur le tesseract, sur l’hyper-cube géométrique, figure cubique et quadridimensionnelle qui fascina Hinton et propulsa dans les intelligences ultérieures les possibilités du Rubik’s Cube. Il est d’ailleurs pertinent de regarder Solénoïde à l’image d’un Cube de Rubik insoluble et textuel, égrenant ses dimensions avec une infaillible autonomie et ajoutant à nos manières de voir et de sentir une féroce dimensionnalité que la littérature confirmée ne saurait nous offrir, pas davantage qu’une institution scientifique se permettrait de concevoir une réciprocité (ou une clé d’élucidation déterminante) entre Hinton et son mariage avec l’une des filles du mathématicien George Boole – Mary Boole en l’occurrence. Il y a donc là un tropisme qui rappelle tant et tant de fantaisies propres à Borges (ce dernier faisant du reste surgir Hinton dans son cuento adéquatement nommé Le Miracle secret eu égard à nos extravagances personnelles sur le narrateur de Cărtărescu), et, aussi, un reflet de tant et tant de défis lancés à la pensée arborescente telle qu’on peut s’en délecter chez Juan Rodolfo Wilcock et sa Synagogue des iconoclastes, recueil de nouvelles où les survivances borgésiennes sont légion. Et cette irruption de la descendance de Boole ne s’arrête pas en si bon chemin puisque le narrateur confesse un durable ensorcellement depuis qu’il a découvert un livre d’Ethel Lilian Voynich, une autre des nombreuses filles de Boole (il en eut cinq au total), quasiment centenaire à son décès en 1960 à New York, surtout reconnue pour son roman Le Taon, publié en 1897, la même année que Dracula, et qui fit se lever d’admiration la société soviétique pour laquelle cette fiction à forte teinture révolutionnaire influença plusieurs générations d’esprits coruscants. Il n’en fallait pas moins pour que l’hyperbolique créature de papier de Mircea Cărtărescu s’adonne à des rapprochements, des recoupements et des déductions plus renversants les uns que les autres, fouillant la trame de ces références jusqu’au vertige métaphysique.
Pour autant, nous le disions, cette métaphysique ou cette excessive auscultation nouménale côtoie sa jupitérienne contradiction par le truchement d’une saisissante descente parmi la stricte réalité phénoménale. Des cimes invariantes de la géométrie et de l’algèbre aux variations effrénées de l’abysse entomologique, il n’y a éventuellement qu’un pas, et l’on savoure maintes fois les odyssées du narrateur vers l’Ithaque d’une population d’acariens, vers la maison-mère des sarcoptes qui semble reproduire à une échelle microscopique les allées et les venues de l’inquiétant macrocosme de Bucarest. Muni d’une déclinaison accrue du principe de charité de W. O. Quine, le narrateur attribue aux insectes galeux des genres de propriétés rationnelles qui pourraient nous aider à optimiser les résultats de l’enquête mathématique. À un certain niveau d’empathie voire d’intropathie vis-à-vis des sarcoptes, le chroniqueur de ce voyage étourdissant n’est pas si loin de décréter une spirale logarithmique dans la nature même du mouvement parasite, mais il est finalement submergé par cet innommable grouillement, par ce langage inarticulé de la nuisance parasitique. On se rend compte en outre que les pages dédiées au périple des sarcoptes (ou du sarcopte fait homme ou de l’homme fait sarcopte) sont assimilables aux problèmes d’épistémologie autrefois soulevés par Thomas Nagel lorsque celui-ci se demandait ce que cela pourrait faire d’être une chauve-souris (7). Évidemment il faudrait être une chauve-souris pour le savoir, mais la performance narrative de Solénoïde est telle qu’il existe des moments de véritable bravoure sémantique – ou des instants de métamorphose que n’eût pas dédaignés un David Cronenberg – transcrivant la très conjecturale pierre de Rosette des acariens. En tous les cas, ce n’est pas exclusivement dans le ciel des Formes platoniciennes et platonisantes que se résout toute l’énigme de la réalité, mais bien en-deçà, dans les entrailles de Bucarest, dans les tripes de cette titanesque ville, là où se croisent et s’agglomèrent en des coïts impensables les inépuisables processions d’acariens et le mesmérisme inouï des solénoïdes qui sont enterrés à divers endroits de la capitale roumaine, dont l’un, pour ne rien arranger, gît à même les fondations de la convulsive habitation du narrateur. Ce sont d’ailleurs ces mêmes solénoïdes qui font entrer Bucarest en lévitation durant l’intermède magique d’une éblouissante vision, à mi-chemin du rêve intégral et du cauchemar lucide, arrachant la ville de ses pilastres enfouis pour la hisser vers les pylônes du firmament, le bas et le haut se rejoignant alors, le terrestre et le céleste se confondant provisoirement afin de supputer une synthèse du matériel et de l’immatériel – une coagulation des expériences et des connaissances.
Mais est-ce là ce qui est essentiel ? Est-ce que la vie de ce professeur de roumain à la fois illuminé (par les hauteurs cognitives) et enténébré (par les gouffres magnétiques) en serait changée radicalement s’il s’avérait que ses obsessions puissent trouver une issue favorable dans le cadre d’une solution finale au mystère du réel ? Une apocalypse émotionnelle survient à l’improviste et le réoriente dans une direction qu’il n’aurait jamais soupçonnée : la vie amoureuse patiemment consolidée et plus spécifiquement la paternité inhérente à cet amour perpétué. En devenant père d’une petite fille avec sa collègue de travail prénommée Irina, en ayant étendu l’amour jusqu’au royaume de l’enfantement, le narrateur renonce assez vite à ses conquêtes encyclopédiques, à ses pactes faustiens, pour se concentrer sur la vie en tant que telle, sur les richesses canonisables, sur les radiations alchimiques induites par la vie d’un enfant qui transfigure ses parents. L’enfant venu au monde le guérit presque d’emblée de ses dérives aussi bien savantes que psychologiques et la scène précise de son renoncement à tout savoir de la vie traduit son enveloppement par l’irréductible mystère de la vie. La petite fille non seulement guérit son père de sa maladie de nouveau Prométhée moderne, mais elle prépare également l’avenir, elle en est la souveraine législatrice. Cette enfant incarne même le plus puissant des solénoïdes car elle offre à son père non plus le contestable surplomb de l’intelligible ou de l’expérimentation aberrante, mais l’incontestable hauteur de la sensibilité vécue, l’irréversible clarté de l’amour que tout enfant porte en lui et qui pourrait même faire fléchir le cœur du diable. Ici s’explique à notre avis les deux mentions du patronyme de Darger dans ce non-roman qui en est un malgré tout : l’enfant que le narrateur a conçu avec Irina provient d’un soleil de justice, d’une lumière divinement brillante, et il apaise la mémoire de l’ermite de Chicago tout en corrigeant les erreurs d’inhumanité du paternel anciennement perdu.
Notes
(1) Armel Guerne, Danse des morts (cette citation et la précédente).
(2) Armel Guerne, ibid.
(3) Ibid.
(6) Javier Marías, Berta Isla (cette citation et la précédente).
(7) Thomas Nagel, What is like to be a bat? (célèbre article de 1974).
[Photos : Martin Broen (The Guardian) - source : www.juanasensio.com]

Sem comentários:
Enviar um comentário