Il aurait eu 101 ans cette année. Brassens, l’anar libertaire tendre et bourru, auteur de dizaines de chansons brillantes et immortelles, est célébré universellement et sans nuance. Pourtant, le parcours du poète sétois au début des années 40 mérite d’être interrogé.
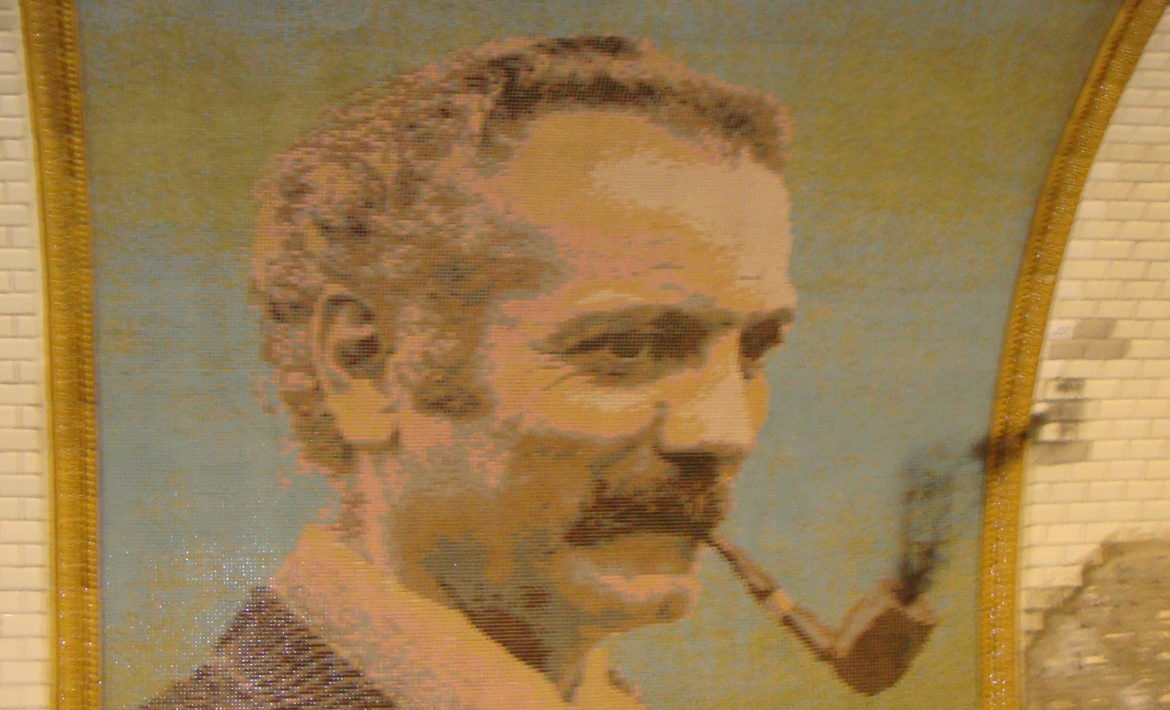
Écrit
Février 1943. L’occupant allemand impose le Service du travail obligatoire (STO) et ordonne aux Français nés entre 1920 et 1922 de rejoindre des camps de travail outre-Rhin pour contribuer à l’effort de guerre nazi. Né en 1921, le jeune Brassens reçoit sa feuille de route à la mairie du 14e arrondissement de Paris. Direction Basdorf, près de Berlin, sous peine de sanctions. Sans emploi, il hésite un moment: s’il s’oppose aux ordres, il causera de nouveaux ennuis à ses parents, dont la réputation a déjà souffert des petits larcins commis par le fiston à Sète, mais aussi à sa tante Antoinette qui l’héberge à Paris. Il décide donc d’obéir.
À Basdorf, petite bourgade située à quelques kilomètres de Berlin, Georges est affecté à l’atelier des cylindres où il s’emploie chaque jour à remettre en état des pièces de moteur d’avion Bramo pour la Luftwaffe. Le soir, après le travail, il cisèle ses premiers textes et noue de solides amitiés. Il a même accès à un piano. Pendant ce temps, en France, quelques dizaines de milliers de réfractaires au STO ont rejoint le maquis et se battent contre l’occupant. En mars 44, alors qu’il est en permission à Paris, Brassens choisit de ne pas retourner en Allemagne. Il se cache quelques mois à la campagne jusqu’à ce que Paris soit libéré en août de la même année.
Pourquoi Brassens le rebelle s’est-il, un temps, plié aux ordres de Vichy? Comment l’antimilitariste farouche a-t-il pu accepter de prêter main forte à l’économie de guerre ennemie? La peur des sanctions? La recherche d’un petit pécule (les travailleurs du STO percevaient un maigre salaire chaque mois)? L’espoir de manger plus ou moins à sa faim en période de disette? Les témoignages s’accordent en tout cas sur un point: Brassens, à Basdorf, supportait mal la souffrance de ses compagnons et partageait volontiers sa gamelle avec ceux qui avaient plus faim que lui. Quant à sa vie d’après-guerre, marquée par onze années passées dans un taudis du sud de Paris sans eau, ni gaz, ni électricité, elle prouve que l’artiste n’était pas le moins du monde matérialiste. Alors? La réponse se cache peut-être dans ses chansons, qui sont, plus qu’un message politique, l’expression d’une vision du monde et d’un mode de vie.
Des chansons en forme de manifeste
Brel était un enragé, Ferré un anarchiste. Gainsbourg s’avouait «aquoiboniste» et Renaud se déclara jadis, le temps d’une chanson, «militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la terre et de l’eau…». Brassens, lui, se positionne plutôt comme un personnage simple et rustique («Auprès de mon arbre je vivais heureux, j’aurais jamais dû m’éloigner de mon arbre»), nourrissant une solide aversion pour la gloire et ses figures imposées («Trompettes de la renommée, vous êtes bien mal embouchées»), sensible à la douleur des hommes («Pauvre Martin»), des femmes («La complainte des filles de joie», «Les sabots d’Hélène») mais aussi de la nature, que les activités humaines abîment («Le grand chêne»).
Il célèbre l’amour, qu’il soit innocent («Les bancs publics») ou interdit («À l’ombre des maris»), mais refuse de le voir institutionnalisé («La non-demande en mariage»). Pas nationaliste pour un sou, il est à peine patriote. À la question que lui pose un jour Bernard Pivot – «Et vous Brassens, vous aimez votre patrie?» – il répond : «Je n’aime pas ma patrie mais j’aime bien la France». Sa seule véritable patrie, c’est l’amitié, une valeur cardinale pour l’auteur des «Copains d’abord» et de «Chanson pour l’Auvergnat». Quant à son engagement politique, il se limite à un antimilitarisme féroce, exprimé notamment dans la chanson «Les 2 oncles», où il renvoie dos à dos l’oncle Martin et l’oncle Gaston, «l’un ami des Tommys, l’autre ami des Teutons». Il ira encore plus loin en rejetant tout militantisme excessif, clamant, non sans humour, et en chanson : «Mourir pour des idées? D’accord, mais de mort lente!».
Rétrospectivement, la posture de Brassens face à l’adversité semble conforme à celle qui prédominait au sein des ouvriers français du STO : ni sabotage, ni zèle, ni lâcheté, ni héroïsme. Une forme d’indifférence stoïque.
Neutralité coupable?
En 1943, Brassens avait 22 ans et son pays était occupé par les nazis. Esprit vif et libre, sans attaches particulières, il aurait pu rejoindre la Résistance. On aurait aimé qu’il soit Joséphine Baker, Saint-Exupéry, René Char ou Romain Gary, ces créateurs de génie qui furent aussi des héros de guerre. Mais le jeune poète avait sans doute déjà décidé que «la musique qui marche au pas, cela ne le regarde pas». Soit. Le dégoût profond de Brassens pour la guerre et ses atrocités l’honore, mais le pacifisme est-il une option quand un ennemi totalitaire vous impose le combat? A-t-on seulement le choix de rester neutre face à Hitler?
Ajoutons que si Brassens a pu par la suite créer librement, c’est bien grâce au sacrifice des autres. «Moi qui n’aimais personne, eh bien je vis encore», écrira-t-il. En effet. Cette liberté d’écrire et de moquer, de pourfendre et de parodier, sans-doute la doit-il à celles et ceux qui sont morts pour elle. Morts pour une idée donc.
Exhumer le passé sans gloire d’une icône est une entreprise nécessaire mais douloureuse, d’autant plus que nul ne sait ce qu’il aurait fait dans une période aussi trouble et périlleuse. Courage ou lâcheté? Engagement ou renoncement? Pour se consoler, on plaidera un droit à la peur, et, à bien y réfléchir, on se réjouira que le poète sétois soit resté bien vivant pour offrir au monde, après la guerre, les fruits de son génie.
[Image de couverture: Brassens © Wikimedia - source : www.leregardlibre.com]
Sem comentários:
Enviar um comentário